– figures de l’exil chez nietzsche –
exil et ontologie (I) | exil, innocence et tragique de l’existence (II) | exil et probité (III)
—
Penser l’exil n’est pas penser le mouvement en tant que tel. Certains « ouvriers philosophiques » pensent le mouvement de la cause vers l’effet, d’une origine au but. Il n’y a mouvement que par intention, il n’y a but que par volonté. Or, le mouvement pour Nietzsche est avant tout nécessaire, ce sont les buts qui en sont contingents. Le champ de forces dionysiaque engendre un multiple irréductible dont la perpétuelle lutte produit le mouvement. Il n’est plus besoin de Dieu, ou de Vérité, ou d’une quelconque métaphysique pour comprendre le devenir. Le Hasard seul décide de l’ordre exceptionnel des choses. L’enfant qui joue aux dés ne choisit pas préalablement la combinaison, ni n’en change le résultat (1). Cette parabole insiste sur le caractère innocent et nécessaire du devenir, à la fois a-téléologique et affirmatif. La vie n’affirme qu’elle-même comme pluralité, souffrance, illusion, mal, joie; elle n’est réductible à aucune unité: « le multiple est la manifestation inséparable, la métamorphose essentielle, le symptôme constant de l’unique. Le multiple est l’affirmation de l’un, le devenir, l’affirmation de l’être.[…] »L’un, c’est le multiple » » (2). Car ce tout est indivisible, il ne peut être tout et multiple que pris dans son entièreté, on ne peut le subsumer dans une métaphysique supérieure:
On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait partie du tout, on est dans le tout, – il n’y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout… Mais il n’y a rien en dehors du tout ! – (3)
Cette affirmation n’est possible pour Nietzsche qu’en arrachant l’homme à la métaphysique, en redéfinissant ce qu’est la condition humaine par le déracinement de l’homme de l’idée de l’Un. L’ontologie de Nietzsche affirme un chaos indépassable, source des pulsions et affects de l’homme et de la nature, dont les individuations, les mises en formes ne relèvent d’aucun dessein et ne révèlent en soi aucun sens. « Le sens est donc une notion complexe : il y a toujours une pluralité de sens, une constellation, un complexe de successions, mais aussi de coexistences, qui fait de l’interprétation un art. (4)». Mais surtout, le devenir, avant toute définition de l’être, est premier. Il n’y a d’être que dans le mouvement, il ne peut s’affirmer que dans son devenir: c’est la Volonté de Puissance qui fait advenir et devenir l’être. Imaginer le monde sans but, sans dieux, une volonté qui ne tend non pas vers, mais pour elle-même, est pour l’esprit le plus formidable obstacle, au point qu’il ne veut y croire lui-même:
Si le monde avait un but, celui-ci devrait forcément être atteint. S’il y avait un état final non intentionnel, il devrait forcément aussi être atteint. S’il était capable de s’arrêter, de se figer, d' »être », s’il ne possédait qu’un seul instant dans tout son devenir cette capacité d' »être », encore une fois il y a très longtemps que tout devenir aurait pris fin, ainsi que toute pensée, tout « esprit ». Le fait que l' »esprit » existe comme un devenir prouve que le le monde n’a pas de but, pas d’état final et qu’il est incapable d’être. – Mais la vieille habitude d’imaginer des buts à tous les événements et de prêter au monde un Dieu créateur qui le dirige, est si puissante que le penseur a de la peine à ne pas se représenter l’absence de but qui est celle du monde comme relevant à son tour d’une sorte d’intention. (5)
Le rôle de l’esprit est l’interprétation du devenir qui donne du sens au mouvement, mais il n’est plus de prêtre, ni de savant pour prêter leurs avenirs, leurs téléologies, qu’elles soient divines ou matérielles, vérités de l’au-delà ou de l’ici-bas. La probité seule demeure comme l’instrument de connaissance de soi sur soi (6). La rupture induite par la proposition l’homme et le monde est rendue insoutenable. Pour Nietzsche, l’homme est le monde, en ce sens qu’il n’y pas d’essence, pas de réduction à l’unique possible derrière la multiplicité originelle des apparences, des masques de la Volonté de Puissance.
La mort de Dieu est fondamentalement la mort de toute métaphysique : « qui nous donna l’éponge pour faire disparaître tout l’horizon ? (7)». Le crime est bien d’avoir rendu l’homme à lui-même « en détachant cette terre de son soleil (8) ». Désormais privé d’une explication métaphysique, l’homme ne peut s’attacher qu’à interpréter, qu’à décrire les phénomènes, sans qu’il n’y ait aucune vérité universelle, ni morale hétéronome: « Il est bien possible que le schème entier en devienne connu. Cela ne change presque rien à notre vie. Pour elle il n’y a, dans tout cela, que des formules désignant des forces absolument inconnaissables (9)». Nietzsche lui-même met en abîme l’angoisse de l’absence de réponse dans le monde, d’absence de but à ce mouvement: « Où nous emporte notre course ? Loin de tous les soleils ? Ne nous abîmons-nous pas dans une chute permanente ? Est-ce en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? (10)».
Ces questions sont celles de l’homme encore sensibles aux ombres de Dieu projetées dans les cavernes; elles sont celles de celui qui constatant la mort de Dieu, se cherche d’autres dieux, d’autres logiques, d’autres anthropomorphismes, d’autres lois, scientifiques ou morales, auxquels croire. Or « le caractère général du monde est au contraire de toute éternité chaos, non pas au sens de l’absence de nécessité, mais au contraire au sens de l’absence d’ordre, d’articulation, de forme, de beauté, de sagesse et de tous nos anthropomorphismes esthétiques quelque nom qu’on leur donne (11)».
La nouvelle condition humaine définie par l’ontologie de Nietzsche est celle d’un exil ontologique, au sens où l’homme est propulsé hors de toute métaphysique ; que son mouvement nécessaire ne poursuit aucun but ; et qu’il n’y a pas de retour possible à une situation originelle idéale. Ainsi, le sens n’est qu’une interprétation précaire et changeante, un travail d’évaluation et d’attributions de valeur sur des phénomènes fondamentalement multiples qui s’inscrivent dans un devenir innocent. À l’infini des possibilités répond la liberté ontologique de l’homme ; mais une liberté qui ne s’ancre dans aucun droit, qui n’est donnée par aucune autorité. L’exil ontologique est ainsi décrit:
Nous avons quitté la terre et nous sommes embarqués ! Nous avons rompu les ponts derrière nous, – plus encore, nous avons rompu la terre derrière nous ! Et désormais, petit vaisseau! Prends garde! Autour de toi s’étend l’océan, c’est vrai, il ne rugit pas toujours, et quelquefois, il s’étend comme soie et or et rêverie de bienveillance. Mais il viendra des heures où tu reconnaîtras qu’il est infini, et qu’il n’y a rien de plus effrayant que l’infinité. Oh quel pauvre oiseau qui s’est senti libre et qui désormais se heurte aux murs de cette cage! Malheur si la nostalgie de la terre te saisit, comme s’il y avait eu là-bas plus de liberté, – il n’y a plus de «terre»! (12)
La liberté potentiellement infinie ne se heurte qu’à la nostalgie de la terre ; devant l’angoisse de l’infini, l’homme recherche l’ombre rassurante de Dieu. L’exil est donc à la fois un déracinement, une rupture de ponts avec une terre qui est consubstantielle de sa nostalgie, de son confort ; et la liberté radicale qui est le fruit de cette rupture, qui doit à chaque fois s’accomplir de son angoisse et de l’appel de la terre, d’un retour à Ithaque. L’idée d’exil implique que le retour à la terre est impossible dans le sens où le retour à l’Identique (13), la matérialisation du souvenir est une illusion, une lubie de l’Un entre le fait et l’idée.
« Allemand » est le nom de la malédiction de la perte des dieux et de la nature : une détresse. « Mais où sont-ils? ». « Maintenant la maison m’est un désert… » L’impossibilité du retour, c’est l’absence de communauté, c’est la déliaison de la communauté. Plus de lieu où revenir : les dissonances de la vie sont impossibles à résoudre. Nous sommes comme des enfants couchés qui ont voulu regarder le soleil et, les yeux brûlés, se tournent face contre terre. (14)
Cette ontologie propulse l’homme dans l’errance, le vagabondage, dans le souvenir d’une terre perdue ou promise que sa mémoire constamment lui rappelle, et l’impossibilité de la rejoindre. La disjonction des deux produit l’angoisse existentielle: l’homme est étranger sur une terre qui lui est familière. Pour parler avec Jankélévitch, l’accomplissement du devenir est toujours entravé par le « je-ne-sais-quoi » et le « presque-rien », l’inadéquation de l’idée et du fait, du désir et de sa réalisation. Plus encore, cet exil nietzschéen exprime la »modernité » par excellence « dans la mesure où celle-ci se définit par l’impossibilité de compenser le réel par des corrections contrefactuelles. La modernité n’est-elle pas définie par une conscience, préalable à toute chose, de la monstruosité des faits, face auxquels le discours des arts et des droits de l’homme ne constitue jamais qu’une compensation et un premier secours ? (15)».
Le tragique de l’existence de l’homme implique l’acceptation du monstrueux qui n’est qu’humain, seulement trop humain. La croyance en une terre ferme, d’une compensation, n’est jamais que l’ombre de Dieu, de l’universel humaniste qui plane sur l’océan infini. Pour Nietzsche, l’expérience de cette angoisse, de chercher du secours et donc du confort, demeure la preuve que la singularité veut se confondre avec l’unité, que le nihilisme réactif prend le pas sur le nihilisme actif et affirmatif. Elle est le contraire de l’affirmation de la vie comme mouvement tragique et chaotique, multiple et incertain. C’est en cela que l’exil ne dérive pas, même dans l’esprit, vers une quelconque terre qui soit plus noble ou plus belle; c’est bien contre l’idée d’une téléologie que s’affirme l’innocence du devenir.
(1) cf. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, p. 29-31
(2) Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, p. 27
(3) Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles, Les Quatre Grandes Erreurs, §8
(4) Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, p. 4
(5) Nietzsche, Fragments posthumes, FP 36 [15]
(6) Nietzsche, Le Gai Savoir, §114
(7) Ibid., §125
(8) Idem
(9) Nietzsche, Le livre du philosophe, §50
(10) Nietzsche, Le Gai Savoir, §125
(11) Nietzsche, Le Gai Savoir, §109
(12) Nietzsche, Le Gai Savoir, § 124
(13) Une pensée que Nietzsche cherchera à dépasser avec l’idée d’Éternel Retour.
(14) Jean Borreil, La raison nomade, p. 246
(15) Peter Sloterdijk, La compétition des bonnes nouvelles – Nietzsche évangéliste, p. 55
(16) Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles, Les Quatre Grandes Erreurs, § 8
Read Full Post »
 Intrigue et exil étaient deux choses intimement mêlées pour les Anciens. Sénèque en fit l’amère expérience en étant relégué de Rome en 41 par l’empereur Claude sur injonction de sa femme Messaline, sous prétexte d’adultère avec Julia Livilla, sœur d’Agrippine. Il y sera finalement rappelé en 49 par cette même Agrippine, devenue entre-temps la quatrième femme de l’empereur Claude (qui avait succédé à Caligula, frère d’Agrippine) pour être le précepteur de son fils Néron. Mais la proximité du pouvoir fut son bourreau, et sans qu’aucune preuve ne fut jamais apportée, Sénèque se trouva pris dans la conjuration de Pison contre l’empereur Néron et fut condamner à mourir en 65.
Intrigue et exil étaient deux choses intimement mêlées pour les Anciens. Sénèque en fit l’amère expérience en étant relégué de Rome en 41 par l’empereur Claude sur injonction de sa femme Messaline, sous prétexte d’adultère avec Julia Livilla, sœur d’Agrippine. Il y sera finalement rappelé en 49 par cette même Agrippine, devenue entre-temps la quatrième femme de l’empereur Claude (qui avait succédé à Caligula, frère d’Agrippine) pour être le précepteur de son fils Néron. Mais la proximité du pouvoir fut son bourreau, et sans qu’aucune preuve ne fut jamais apportée, Sénèque se trouva pris dans la conjuration de Pison contre l’empereur Néron et fut condamner à mourir en 65. Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie, car nous n’entendons plus vivre ces sentiments qui nous sont devenus étrangers. Car nous sommes seuls avec cet élément étranger entré en nous ; car nous a été provisoirement retiré tout ce qui nous était familier et habituel ; car nous nous trouvons au milieu d’un flot auquel nous ne pouvons résister. C’est pourquoi la tristesse passe, elle aussi : ce qui en nous est nouveau et est venu s’ajouter est entré dans notre coeur, a pénétré dans sa cavité la plus secrète et n’y est déjà plus – est déjà dans notre sang. Et il ne nous sera pas révélé ce qui fut. On pourrait facilement croire qu’il ne s’est rien passé et pourtant nous nous sommes transformés comme se transforme une maison où est entré un hôte. Nous ne saurions dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des signes nous l’indiquent : c’est l’avenir qui de cette façon pénètre en nous pour s’intégrer à nous bien avant d’advenir. Et voilà pourquoi il est si important d’être solitaire et attentif quand on est triste : car l’instant où en apparence rien ne se passe ni n’évolue est celui où notre avenir pénètre en nous, bien plus proche de la vie que cet autre moment bruyant et fortuit où il advient comme du dehors. Plus dans nos tristesses nous sommes silencieux, patients et ouverts, plus ce qu’il y a de nouveau pénètre en nous profondément, infailliblement, mieux nous nous l’approprions, plus il sera « notre » destin ; quand plus tard il « adviendra » (c’est-à-dire, nous quittera pour aller aux autres), nous nous sentirons au plus profond de nous apparentés étroitement à lui. Et voilà qui est nécessaire. Il est nécessaire – et c’est dans cette voie que peu à peu nous évoluerons – que nous ne soyons affrontés à rien d’inconnu mais seulement à ce qui nous appartient depuis longtemps. Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement, il va falloir aussi apprendre progressivement à comprendre que ce que nous appelons le destin, loin d’entrer de l’extérieur dans les hommes, sort de ceux-ci. C’est uniquement pour ne pas avoir absorbé leurs destinées tant qu’elles vivaient en eux et ne pas en avoir fait leur propre substance qu’ils n’ont pas compris ce qui sortait d’eux ; elles leur étaient si étrangères que, dans une confuse terreur, ils s’imaginaient qu’elles venaient forcément d’entrer tout juste en eux, car ils auraient juré de n’avoir jusqu’à ce jour jamais rien trouvé de semblable en eux-mêmes. De même qu’on s’est longtemps trompé sur le mouvement de l’avenir. Le futur est fixe, cher monsieur Kappus, tandis que nous, nous sommes en mouvement dans l’infini de l’espace.
Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie, car nous n’entendons plus vivre ces sentiments qui nous sont devenus étrangers. Car nous sommes seuls avec cet élément étranger entré en nous ; car nous a été provisoirement retiré tout ce qui nous était familier et habituel ; car nous nous trouvons au milieu d’un flot auquel nous ne pouvons résister. C’est pourquoi la tristesse passe, elle aussi : ce qui en nous est nouveau et est venu s’ajouter est entré dans notre coeur, a pénétré dans sa cavité la plus secrète et n’y est déjà plus – est déjà dans notre sang. Et il ne nous sera pas révélé ce qui fut. On pourrait facilement croire qu’il ne s’est rien passé et pourtant nous nous sommes transformés comme se transforme une maison où est entré un hôte. Nous ne saurions dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des signes nous l’indiquent : c’est l’avenir qui de cette façon pénètre en nous pour s’intégrer à nous bien avant d’advenir. Et voilà pourquoi il est si important d’être solitaire et attentif quand on est triste : car l’instant où en apparence rien ne se passe ni n’évolue est celui où notre avenir pénètre en nous, bien plus proche de la vie que cet autre moment bruyant et fortuit où il advient comme du dehors. Plus dans nos tristesses nous sommes silencieux, patients et ouverts, plus ce qu’il y a de nouveau pénètre en nous profondément, infailliblement, mieux nous nous l’approprions, plus il sera « notre » destin ; quand plus tard il « adviendra » (c’est-à-dire, nous quittera pour aller aux autres), nous nous sentirons au plus profond de nous apparentés étroitement à lui. Et voilà qui est nécessaire. Il est nécessaire – et c’est dans cette voie que peu à peu nous évoluerons – que nous ne soyons affrontés à rien d’inconnu mais seulement à ce qui nous appartient depuis longtemps. Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement, il va falloir aussi apprendre progressivement à comprendre que ce que nous appelons le destin, loin d’entrer de l’extérieur dans les hommes, sort de ceux-ci. C’est uniquement pour ne pas avoir absorbé leurs destinées tant qu’elles vivaient en eux et ne pas en avoir fait leur propre substance qu’ils n’ont pas compris ce qui sortait d’eux ; elles leur étaient si étrangères que, dans une confuse terreur, ils s’imaginaient qu’elles venaient forcément d’entrer tout juste en eux, car ils auraient juré de n’avoir jusqu’à ce jour jamais rien trouvé de semblable en eux-mêmes. De même qu’on s’est longtemps trompé sur le mouvement de l’avenir. Le futur est fixe, cher monsieur Kappus, tandis que nous, nous sommes en mouvement dans l’infini de l’espace.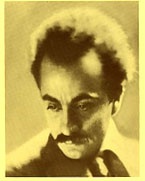 But you, children of space, you restless in rest, you shall not be trapped nor tamed.
But you, children of space, you restless in rest, you shall not be trapped nor tamed.